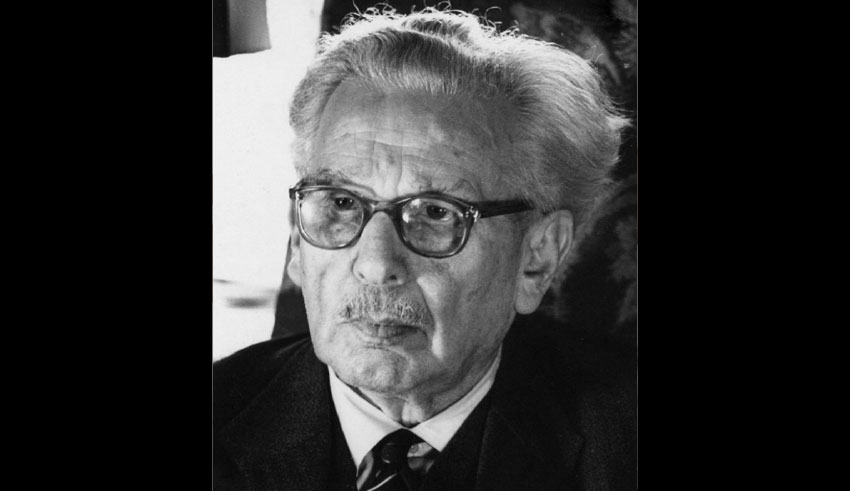
La psychiatrie ne semble pas faire une place particulière à la question de la justice dans les stratégies de guérison qu’elle essaie de mettre au point. Et Binswanger, le fondateur de la Daseinanalyse, ne fait pas exception. Mais son concept d’amour, auquel il attribue le statut de disposition fondamentale de l’âme, pourrait bien ouvrir une brèche… En tout cas, le dialogue entre nos trois protagonistes en explore les possibilités.
Po : Avez-vous remarqué qu’il règne une grande confusion en ce qui concerne le juste et l’injuste parmi nos contemporains ? Je fais cette remarque en me remémorant le mythe que nous avons évoqué la semaine dernière, qui raconte que les dieux ont offert à l’homme le don de la justice pour qu’il puisse établir une relation de paix dans ses relations avec ses congénères. C’est à croire que ce don, nous l’avons égaré en chemin…
Md : La famille est, depuis toujours, la grande école en matière de justice. Or il semble qu’elle ne parvienne plus à remplir son rôle convenablement. Nous sommes en plein dans le conflit des systèmes de valeurs : l’idéologie s’est insinuée partout en faussant cette prédisposition que nous avons naturellement à distinguer le juste de l’injuste.
Ph : Je note pourtant que les Grecs avaient conçu une autre école, en dehors de celle de la famille, pour enseigner la justice aux hommes. Et c’est la tragédie. Est-ce qu’il n’est pas assez clair qu’une tragédie est la représentation d’un drame à l’intérieur duquel chacun reçoit selon son dû, comme on dit. Mais cette justice est à la fois humaine et divine, et peut-être davantage divine qu’humaine…
Md : Oui, c’est un aspect essentiel, je crois bien. Pourtant, il en est rarement question dans le travail de la critique littéraire. On met ça sur le compte des spécificités religieuses des Grecs et on passe aux aspects plus techniques de la psychologie des personnages, de l’agencement des éléments de l’action dramatique, de la nature du langage…
Ce phénomène d’évitement de la question de la justice, c’est curieusement ce que je retrouve aussi dans la pratique de la psychiatrie…
Ph : Oui, nous avons eu l’occasion de noter cette préoccupation chez toi. Mais ta conception des choses n’a sans doute pas pu s’exprimer de façon suffisamment ample. Tu avais évoqué, il y a quelques semaines, cette idée d’un médecin qui aurait l’âme d’un juge, en faisant remarquer que le médecin qui n’aurait pas cette compétence judiciaire, cette capacité à dire ce qui est juste et ce qui est injuste dans le récit des événements, ce médecin ne pourrait pas opérer de renversement salutaire dans l’état mental de son patient… C’est bien ça ?
Md : Oui, mon idée est que le médecin doit être un juge mais elle est surtout qu’il doit aider le patient à devenir lui-même un juge. Il y a un travail de passation de pouvoir qui n’est possible que si le médecin a acquis au préalable une connaissance profonde de la justice.
Po : Un juge est quelqu’un qui ne se contente pas d’apprécier les événements selon le récit qui lui en est rapporté. Il y a chez lui une démarche qu’on qualifiera d’investigatrice et d’inquisitrice. Et ce point m’est revenu à l’esprit lorsqu’il a été question, la semaine dernière, d’approche phénoménologique et de Daseinanalyse en psychiatrie. Je me suis demandé s’il n’y avait pas une difficulté à concilier cette approche avec l’idée du psychiatre-juge…
Md : Tu mets le doigt sur une question importante qui occupe ma pensée. Depuis que nos rencontres se déroulent de façon régulière chaque semaine, je vous ai exprimé plusieurs fois ma position selon laquelle la psychiatrie souffre d’un problème de statut, en tant que branche de la médecine. On considère que l’âme est une région parmi d’autres du patient, et on l’aborde avec ce présupposé qu’une certaine réponse thérapeutique va apporter à la souffrance vécue par le patient le soulagement souhaité, de la même façon que les choses se passeraient pour une souffrance ressentie dans les os ou au niveau de l’estomac. C’est d’ailleurs ce qui a fait que la révolution des antidépresseurs a mis en berne, pour ainsi dire, l’agitation que la psychiatrie a connue autour des innovations de la psychanalyse et de la psychothérapie institutionnelle : toutes ces approches qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu tendance à associer le patient au processus de sa propre guérison… Ce qui veut dire que ces approches nouvelles ont engagé une révolution qui est demeurée inaboutie et que la raison de cet échec est justement que le statut de la psychiatrie comme «spécialité», comme branche de la médecine, a repris le dessus.
Mais il y a une autre idée qui s’ajoute à celle-ci dans ma lecture critique de l’évolution de la psychiatrie, à savoir que le mal psychique tel qu’il est thématisé et étudié dépend lui-même d’un certain prisme. En ce sens que les psychiatres qui échafaudent des théories sur les maladies mentales le font généralement à partir d’observations réalisées sur leurs patients. Or les hommes qui souffrent d’un mal psychique ne décident pas toujours ou ne sont pas nécessairement conduits à se constituer en «patients». Les souffrants auxquels a affaire le psychiatre sont presque toujours ceux que leur mal a mis en situation d’échec, qu’ils ne parviennent plus à avancer. Or il y en a d’autres qui ne sont pas moins des souffrants et qui pourtant ne vont jamais envisager d’aller «consulter» ni, encore moins, se laisser interner. Soit parce qu’ils ont réussi à donner à leur souffrance l’apparence d’une normalité et que c’est un expédient qui fonctionne et auxquels ils tiennent parce que synonyme d’honorabilité, soit parce que leur mal psychique est devenu chez eux un moteur de puissance par quoi ils sont parvenus à exercer une domination sur leur entourage : et c’est le cas du tyran que nous avons évoqué à propos de l’Antigone de Sophocle.
On a donc deux limitations dans l’approche de la folie ou du trouble mental : celle qui est déterminée par la psychiatrie en tant que simple branche de la médecine et, d’autre part, celle qui est déterminée par le profil particulier du souffrant, à savoir celui qui est demandeur —malgré lui— de soins. La conception clinique de la folie subit cette double limitation, mais elle n’a pas l’air d’être consciente du problème lorsqu’elle prétend énoncer des vérités générales sur les phénomènes des troubles mentaux. Or, de mon point de vue, c’est cette double limitation qui empêche d’apercevoir l’importance et de la question de la justice dans l’épreuve du mal psychique et de la dimension judiciaire de la «guérison», si tant est que ce dernier mot soit le bon…
Po : Je note pourtant que tu avais eu des propos élogieux à propos de Ludwig Binswanger et de sa notion d’amour…
Md : Binswanger tombe sous le coup de ma critique, malgré le combat méritoire et pertinent qu’il mène contre la psychiatrie traditionnelle. A vrai dire, c’est surtout le deuxième volet de ma critique qui le concerne : les études qu’il a réalisées et dont il a fait la substance de ses publications sont tirées des observations faites dans sa fameuse clinique de Bellevue, au nord de la Suisse, dans cette ville de Kreuzlingen qui se situe au bord du lac de Constance. Mais il est vrai en même temps que son souci est globalement étranger à cette question de l’approche judiciaire qui, moi, me paraît essentielle. Cela dit, je pense qu’il faudrait nuancer le propos en disant qu’il y a entre la notion d’amour et celle de justice une sorte de perméabilité… Je vous ai dit la fois dernière que c’est par l’amour que le psychiatre se donnait le moyen d’envisager le patient dans sa singularité, indépendamment de toute théorie préconçue qui chercherait à le caser dans l’anonymat d’une quelconque généralité. Et j’ai ajouté que c’est aussi par l’amour qu’il pouvait s’avancer à la rencontre de la souffrance qui loge au cœur du patient. Car l’amour est compassion: capacité de «souffrir avec» ! Donc de consolation… Mais on peut se poser la question: est-ce que la consolation, dans le cas du mal psychique, peut avoir lieu sans réhabilitation, sans que justice n’ait été rendue ?
Ph : Cette notion d’amour porterait en elle, finalement, ce que tu appelles «l’approche judiciaire»… Mais est-ce que tu conçois que l’amour engage lui-même ce travail d’investigation et d’inquisition dont il est question dans l’approche judiciaire ? Et à quoi ça ressemblerait ?
Md : L’investigation suppose que le psychiatre engage le patient à se remémorer des événements que ce dernier a enfouis dans l’oubli et qui ont joué un rôle dans une expérience de dégradation subie par lui. Le psychiatre envisage des pistes, pressent des drames et pousse le patient à la façon d’un sourcier dont il attend qu’il confirme ses intuitions. Mais l’investigation ne suffit pas. Pourquoi elle ne suffit pas ? Parce que, greffé sur l’oubli, il y a le déni. Et, pour achever de cadenasser les choses, il y a le déni du déni. De sorte que le patient présente toujours un psychisme barricadé… Et armé !
Po : Armé ? Voilà qui complique les choses pour l’amour! Mais que veux-tu dire par là : armé ?
Md : Oui, barricadé et armé. C’est pourquoi l’investigation doit laisser place à l’enquête et à l’interrogatoire. C’est le volet policier de la procédure judiciaire. Le patient a beau demander d’être délivré de son mal, il n’en continue pas moins de produire les causes qui rendent ce mal si difficile à déloger. J’utilise le mot «armé» pour signifier le caractère actif de la façon dont le patient résiste à l’action de mise en lumière de son mal. Cette résistance prend une forme double : en empêchant l’approche par des actions de diversion d’une part et, d’autre part, en donnant de soi l’image factice d’une personnalité normale, voire plus normale que la normale, et en l’imposant comme la seule vraie. Parfois de façon très autoritaire, voire tyrannique. Ne dit-on pas que la meilleure défense, c’est l’attaque ? Le malade a fait sienne ce dicton. Il y a chez lui une tyrannie constitutive, en vertu de laquelle il exerce son action de déni à propos de sa propre souffrance… La question qu’on peut se poser à ce stade est la suivante : qu’est-ce qui, dans le trouble mental, explique cette urgence vitale à dissimuler ?
Ph : C’est en effet la question qu’on se pose mais, dans le même temps, je crois utile de faire la remarque que le malade ne se découvre malade que lorsque son système de défense craque, s’épuise… C’est à ce moment là qu’il y a une sorte d’alarme face à quoi il est sans recours. C’est la crise, qui peut emporter le malade dans la perte de sa conscience, dans l’effondrement de la folie. Il y a donc deux moments distincts dans la maladie : un moment de latence et un autre de manifestation du mal. Or beaucoup de gens sont des malades dont la période de latence est durable: ils s’installent dans une personnalité artificielle, dans un moi «chosifié» pour parler le langage de Sartre, et rien ne vient jamais bouleverser leur édifice. Qui est pourtant mensonger.
Md : En effet, c’est encore un paradoxe qui fait croire à certains que ce qui se contente de révéler le mal en est la cause. A vrai dire, la maladie mentale est toujours une construction. Il y a une souffrance initiale qui sert de point de départ. C’est, pour ainsi dire, l’occasion à la faveur de laquelle le travail de construction se met en place. Puis il y a une seconde souffrance, qui est liée à l’étouffement que va créer cette excroissance anarchique, cette sorte de tumeur mensongère dans la vie psychique. Il arrive que le malade s’accommode de cette situation de dédoublement de sa personnalité. Mais il arrive aussi, et c’est le troisième étage de la construction, que la tension entre le mensonge et ce sur quoi il y a mensonge devienne intenable. Qu’il y ait donc épuisement du système mensonger qu’est le «moi social», comme dit Freud.
Po : Et c’est là que se produit ce moment critique, et pourtant salutaire, qu’est l’écroulement de l’édifice mensonger ! Qu’est-ce qui fait que ce moment survienne dans certains cas et pas dans d’autres ?
Md : Les causes sont multiples, et l’issue peut en effet être salutaire. Mais, justement, il faut revenir un peu en arrière et se poser la question que je formulais il y a un instant : qu’est-ce qui motive l’alarme du malade à l’idée que soit dévoilée sa souffrance ? Cette alarme est à la racine de la construction et elle est aussi présente dans le moment de l’effondrement de l’édifice. Ma conviction, qui rejoint la pensée de Binswanger, est que l’alarme est liée à une perte d’amour. J’insiste ici sur la mention du nom de Binswanger, pour éviter celui de Freud, parce que la notion d’amour n’a pas du tout la même connotation chez l’un et chez l’autre. L’amour chez Binswanger est une disposition fondamentale : il n’est pas dans le monde, il est ce par quoi il y a monde. La perte de l’amour, ce n’est pas la frustration d’un désir : c’est une blessure dont l’ouverture est celle d’un monde.
Po : La conception habituelle que l’on se fait de ce besoin impérieux du refoulement, c’est qu’il y a un traumatisme insoutenable que la mémoire a évacué…
Md : Cette explication a le défaut de ramener l’âme sur le terrain des phénomènes physiques. La remémoration du traumatisme peut assurément créer du déplaisir, mais elle est tout à fait insuffisante pour justifier la mise en place de tout un système de défense. Ce genre d’explication manque cruellement de pertinence, mais se maintient parce qu’il est au service d’une certaine paresse intellectuelle qui cherche à réduire le drame mental au modèle du choc traumatique que peut subir le corps. S’il y a traumatisme, c’est celui d’une répudiation qui est une «fin du monde» et qui est une injustice. Quand je dis «injustice», j’entends qu’il n’y a pas de dénouement du drame sans réparation et sans réhabilitation.
Po : Tu as dit, il y a peu, que le moment initial était «l’occasion» à partir de laquelle la construction de la personnalité factice se mettait en place. Tu suggérais par là que ce moment était contingent. On comprend que, selon toi, le drame initial n’a fait que créer les conditions grâces auxquelles le piège est apparu qui s’est refermé sur l’âme. Or il semble à présent que retrouver ce moment et le revivre soit devenu une clé pour comprendre le drame intérieur et s’en libérer. Mais peut-être n’est-il pas possible de le retrouver, ce moment ! D’autre part, comment peut-on être sûr que ce qu’on croit être le moment initial est vraiment le moment initial ?
Ph : Je ne pense pas que cette recherche de commencement corresponde à une démarche d’historien. Peu importe à la limite que ce commencement renvoie à un événement réel du passé ou qu’il soit librement restitué grâce au concours de l’imagination. Ce qui compte, c’est que devienne claire la manière dont s’est noué le drame…
Md : Oui, le travail de l’imagination est essentiel. Le retour au commencement du drame est toujours le fruit d’une action concertée entre l’imagination et la mémoire.
Po : Action concertée ! Ça sonne assez étranger à cette résistance dont tu parlais tout à l’heure.
Md : Oui, bien sûr : quand cette recherche du commencement est engagée, un retournement a déjà eu lieu. La résistance est toujours là, mais s’est réveillé entre temps un désir de vérité, qui la bouscule et se fraie son chemin à travers ses obstacles.
Po : Comment s’est produit ce retournement ?
Md : C’est le miracle de l’amour : il a résisté vaillamment à la tyrannie du déni —comme Antigone à Créon— puis il a semé les germes d’un nouveau monde, face auquel les constructions mensongères du déni sont vouées à la destruction. Voilà ce qui suscite dans le patient un désir de sortir de son piège. Son ancienne peur d’être dégradé et rejeté s’est perdue dans le vaste territoire de l’amour et de son accueil sans limites.
Ph : Cette réponse est un hymne à la pensée de Binswanger, non ?
Md : Difficile de le nier ! Mais, je le répète : pas de réhabilitation sans réparation, et pas de réparation sans un processus judiciaire… Tout ça ne contredit pas le miracle !












